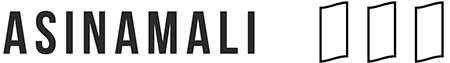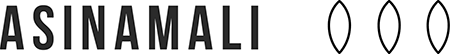La philosophe Eleonora de Conciliis, prolifique en livres et articles (Il potere della comparazione. Un gioco sociologico ; Che cosasignifica insegnare ?), a un goût de l’exploration — de la diversité des pensées critiques et des thèmes contemporains — qui s’appuie sur des raisonnements approfondis, possédant une grande rigueur.
Avec son essai Violence et métamorphoses, Le pouvoir des mots et de l’écriture, elle développe une thèse convaincante sur le rôle de l’écrivain et la fonction de l’écriture. Pour cela, elle convoque Freud, Elias Canetti, Kafka, et bien d’autres. Après une suspicion sur l’intérêt des études littéraires, au début du siècle (voir Todorov, Maingueneau, Compagnon, W. Marx…), on a le plaisir de rencontrer une longue analyse, qui, avec quelques traits barthésiens, s’attache à mettre l’accent sur l’auteur, en tant que « corps » éthique, et qui énonce des concepts prometteurs.
On y note les maîtres-mots : violence, pouvoir, sublimation, métamorphose, « devenir autre », jouissance et écriture. La démonstration n’appelle pas un système, elle étaye une thèse sur la relecture, en quelque sorte, d’une « psycho-philosophie de l’écriture ».
Le livre comporte deux grands chapitres. Dans le premier (Sous l’herse en verre. Kafka et le sens de la violence.), le plus court, est proposée une définition de la « violence », avec des distinguos de Girard et Sartre, et l’exemple saisissant de l’écriture, inscrite littéralement sur la peau, relaté dans le récit Dans la Colonie pénitentiaire, de Kafka. La constatation de cette violence (historico-processuelle) amène à s’interroger sur l’antidote que représente sa transformation linguistique (l’écriture) opérée par/dans la métamorphose. Ainsi, la violence disparaît grâce à sa transposition dans le langage.
Cependant, c’est dans le deuxième chapitre (Le gardien des métamorphoses. Pour une critique scripturale de la sublimation) que l’essai dresse un manifeste.
Il articule toute une pensée originale, marquant un tournant de la figure auctoriale — qui avait été tant noircie dans les études romantiques, lyriques et « médiatiques », dont la « mort de l’auteur », tant de fois annoncée, s’épuisait en « biographismes » spectaculaires — Eleonora de Conciliis récupère cette figure avec brio et tout en douceur (elle n’oublie pas l’héritage de la mission du créateur, mais la rend moins sacrée).
D’abord, il s’agit de s’interroger sur le lien entre l’écriture, la sublimation et la métamorphose. En remettant en cause la négativité freudienne (et ses idées d’inhibition) d’une sublimation artistique, associée à la pulsion de mort, elle énonce l’existence de pulsions métamorphiques, où la sublimation scripturale n’est pas frappée de pathologie. Forte de ces postulations post-psychanalytiques, elle insiste sur le fait que le littérateur pratique une technique de subjectivation métamorphique. Elias Canetti l’appelait le « gardien des métamorphoses ». Ainsi, le sublime, dans la raison, appartient à une écriture constante, jubilatoire et non funeste. Cette sublimation scripturale se constitue dans un événement pulsionnel éthico-érotique.
Ensuite, il s’agit d’une transformation « dans quelque chose de différent » de l’auteur et non pas la transformation « de quelque chose ». Celui qui écrit ne « se décharge » pas dans autre chose. Nous sommes bien loin de cette totalité réductrice du « monstre » (sacré ou pas) démiurgique. Le corps de l’écrivain se frotte à son tracé scriptural, qui est un devenir autre (deuxième sous-partie : L’art de devenir autre) qui fixe aussi une frontière. Raisonné, il s’arrête au seuil de l’altérité. L’auteur se situe au centre de la création et il accomplit un travail dé-subjectivant (avec une faculté d’oubli), où il se transforme, tout en éprouvant un plaisir (orgasmique) de rencontrer un autre réel.
La philosophe revient judicieusement sur ses présupposés thétiques en les renforçant : il faut comprendre qu’il ne s’agit pas « d’une forme de compensation ou de névrose »