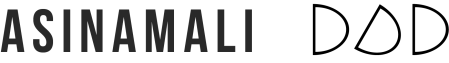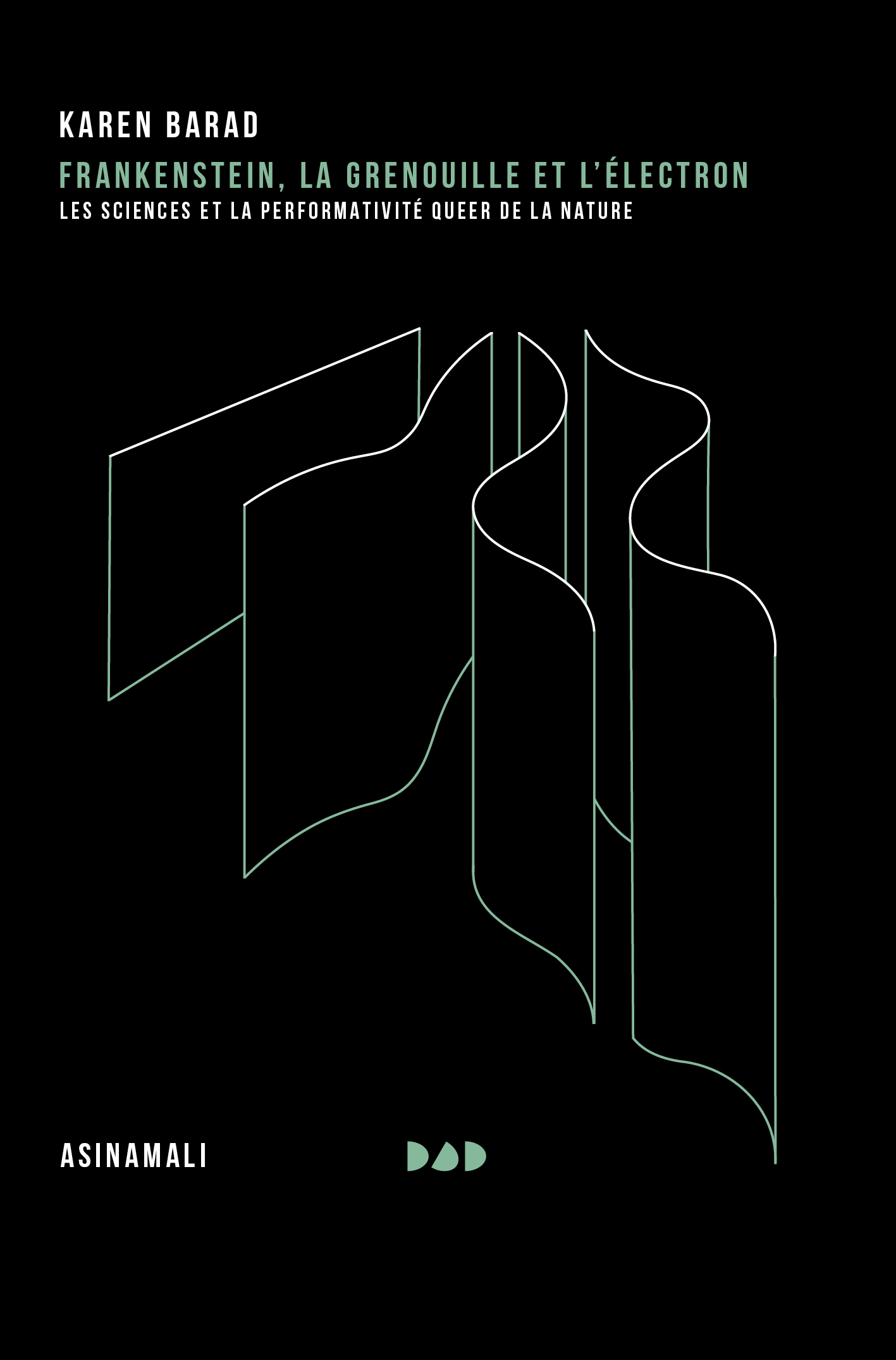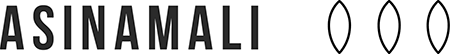Frankenstein, la grenouille et l’électron peut en lui-même être considéré comme un ouvrage queer, caractéristique d’une « multiplicité changeante et subversive » (p. 93). Son autrice, Karen Barad, figure phare de la pensée réaliste et posthumaniste, est à la fois docteure en physique quantique et professeure d’études féministes, de philosophie et d’histoire de la conscience. C’est dire la diversité de ses intérêts et l’étendue de son expertise scientifique. Cet ouvrage n’est par ailleurs pas une simple traduction d’un ouvrage antérieur mais il réunit pour la première fois cinq essais différents en styles, longueurs et contenus, traduits pour la première fois en français. La rigoureuse et fidèle traduction par Luigi Balice et Christophe Degoutin de ces essais représente une occasion bienvenue pour les lecteur·rice·s francophones, celle de découvrir la pensée foisonnante et stimulante de Barad et de se familiariser avec ses concepts et théories.
L’ouvrage s’ouvre avec une préface de Joseph Rouse qui donne quelques clés pour s’initier à la pensée de l’autrice. Il insiste notamment sur la radicalité de l’approche de Barad qui questionne les binarismes structurant nos manières de penser et d’être au monde. Le premier chapitre de l’ouvrage, intitulé « Performativité posthumaniste : cette matière qui compte », est la traduction d’un article qui a beaucoup marqué les sciences humaines et sociales. Paru en 2003 dans la revue d’études féministes Signs1, ce texte propose une analyse performative du rôle de la matière. Barad y étudie les pratiques, les actions et, en général, le « faire » de la matière. Elle mêle ici des éléments issus de la métaphysique atomiste de Démocrite et de la physique quantique de Niels Bohr à des éléments de la philo-sociologie de Donna Harraway. Dans ce premier chapitre, Barad définit de nombreux éléments qui caractérisent sa pensée. Celle-ci vise notamment à produire une analyse rigoureuse de la matérialisation de tous les corps, animés et inanimés, et des pratiques matérialo-discursives qui les constituent de manière différentielle. Elle propose alors le concept de « réalisme agentiel » qui « s’articule autour de pratiques […] qui intègrent les perspectives féministes, antiracistes, post-structuralistes, queer et marxistes aux science studies » (p. 40). Par cette perspective épistémologique, théorique et méthodologique, Barad suggère que notre manière d’être au monde fait déjà le monde, dans le sens que nous faisons partie d’agencements particuliers qui rendent possibles certains états du monde au détriment d’autres. L’un des concepts centraux est celui d’intra-actions, celles-ci s’opposant aux interactions en soulignant « l’inséparabilité ontologique des “composantes” intra-agissantes agentiellement » (p. 49). Pour Barad, les phénomènes sont des « relations ontologiquement primaires » (p. 49), c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de concevoir le monde comme constitué d’objets ontologiques séparés, de bouts de matière isolés, mais de comprendre le monde en tant que phénomènes de relations entre ces éléments qui intra-agissent à l’intérieur même du monde. Ce sont ces relations, ces intra-actions, qui servent de points de référence significatifs à son analyse. Barad suggère ainsi que la réalité est composée de « “choses-”dans-les-phénomènes », et que le monde est l’intra-activité productrice de sens, « un processus dynamique d’intra-activité qui reconfigure sans cesse les structures causales et leurs instanciations locales, c’est-à-dire leurs contours, leurs propriétés, leur sens ou leur signification, y compris les traces et les motifs réguliers qu’elles laissent sur les corps » (p. 53). L’essai se termine sur une réflexion concernant la nature radicalement ouverte de l’avenir et la responsabilité qui découle de la possibilité d’agir qui existe à tout moment. C’est donc sur une note politique – il est possible d’agir – que se termine cet essai aussi magistral que complexe.
Le deuxième texte présenté s’intitule « La performativité queer de la nature » et est paru en 2012 dans une revue danoise2. Il prend comme point de départ un article du New York Times sur la prolifération d’amibes sur le sol du Texas. Cet article, que Barad décrit comme emprunt de la peur du communisme et d’idées moralisatrices, permet de tisser un lien entre biologie, sociologie et politique. En effet, l’autrice montre que le nom commun donné à ces amibes, le « Blob », est aussi le titre d’un film produit en pleine guerre froide (Danger planétaire en français, 1958). « Quelque forme qu’elle prenne, la peur du Blob reste très présente dans la vie politique contemporaine. Lorsqu’on s’aventure dans la boue gluante de la moralité, de la politique et des liquides biologiques, alimenter gratuitement des réactions de peur n’a rien d’innocent » (p. 86). Ce chapitre examine ainsi le caractère moral de la nature, et la place de l’humain dans la nature. En s’inspirant de diverses formes de créatures in/animées présentes autour de nous, Barad réfléchit à l’essence même de l’agentivité, de la relationnalité et à ce qui fait que le monde change et se transforme continuellement. On comprend alors pourquoi Barad considère la nature comme un objet queer, fait d’intra-actions entre des entités très différentes l’une des autres. Barad ne fige aucune définition du mot queer mais préfère considérer le queer comme un questionnement de l’identité et des binarismes, « un organisme mutant, une ouverture radicale désirante, une multiplicité changeante et subversive, un disciple de Protée, une dis/continuité agentielle, une spatio-temporalité repliée sur elle-même, en perpétuelle matérialisation itérative et d’une promiscuité ingénieuse […], l’essence même de l’espacetempsmatière-en-devenir [spacetimemattering] » (p. 93 et suivantes). Cette propriété queer de la nature se retrouve même dans l’entité de base de la matière : l’atome. S’appuyant sur ses propriétés physiques étranges, par exemple le fait de se comporter comme une onde ou une particule selon les situations et le dispositif d’observation, elle décrit l’atome comme une entité « “ultraqueer” qui queerise la queerité elle-même » (p. 93). Elle donne ensuite une série d’exemples qui l’aident à remettre en question l’ontologie classique basée sur les binarismes nature/culture et humain/non-humain, et de finir, là encore, sur une note politique : « La question de la responsabilité ne peut pas s’appuyer sur une mathématique de l’identité » (p. 147 et suivantes).
C’est à la découverte d’une sorte d’étoile de mer que nous mène le troisième essai, « Visions invertébrées : les diffractions de l’ophiure », paru en 2014 dans un ouvrage dirigé par Eben Kirksey3. La particularité de cette espèce appelée « ophiure » est qu’elle possède un système squelettique qui leur sert aussi de système visuel. Autrement dit, elles ne possèdent pas d’yeux, mais voient à travers l’entier de leur corps. En partant de l’exemple de l’ophiure, Barad élabore ici une intense réflexion sur ce que signifie être un organisme vivant. En tant que « véritable contestation vivante du binarisme organique-inorganique » (p. 171), l’ophiure nous permet de repenser nos conceptions d’espace et de temps. Selon l’autrice, il n’y a pas d’intérieur ou d’extérieur absolus et le cas de l’ophiure illustre à quel point il est nécessaire d’avoir une vision plus complexe du corps que le simple constat des contours visibles de celui-ci.